Découverte
L’Estuaire de la Gironde autrement
Lorsqu’on évoque l’estuaire de la Gironde, une image vient en tête : le phare de Cordouan et son classement au patrimoine mondiale de l’Unesco. Mais, au-delà de ce monument emblématique, l’estuaire mérite un regard tout particulier.
Lorsqu’on évoque l’estuaire de la Gironde, une image vient en tête : le phare de Cordouan et son classement au patrimoine mondiale de l’Unesco. Mais, au-delà de ce monument emblématique, l’estuaire mérite un regard tout particulier.
On connait tous l’estuaire de la Gironde, mais que sait-on vraiment de lui ? On le situe géographiquement, des Mathes en passant par Barzan, St-Dizant-du-Gua ou encore St-Ciers-sur-Gironde, en allant plus au sud, en Gironde, de Braud-Saint-Louis, en passant par Blaye, pour rejoindre le Médoc et le Verdon-sur-Mer, relié par un bac pour rejoindre Royan. Il s’étend sur près de 80 kms. Quid de la genèse cet estuaire, de ses richesses, de sa vie économique ?
La Région Nouvelle-Aquitaine a publié un ouvrage intitulé Estuaire de la Gironde, deux rives, un territoire. Elle a collaboré avec les services régionaux du patrimoine et de l’inventaire d’Aquitaine et du Poitou-Charentes afin de mener une grande étude du patrimoine des communes riveraines de l’estuaire. « L’ambition de ce livre est de définir et de qualifier la singularité de ce territoire, espace fluvio-maritime pluriel qui, s’il ne se résume pas à la seule présence de l’estuaire, est largement structuré par ce bras de mer », explique-t-on. Des documents, des archives, des cartes analytiques permettent de mieux prendre la mesure de l’importance de l’estuaire.
À l’image de celui-ci qui aspire à une pause, prendre le temps de feuilleter, de lire, de regarder les innombrables photos, dessins, croquis, s’impose comme une évidence.
Il faut remonter à 46 millions d’années pour la formation de l’estuaire, « lorsque la Garonne, déplacée vers le nord à la suite de la fermeture du bassin aquitain par les Pyrénées, a rejoint le réseau hydrographique issu du Massif Central. » Le « schorre » et la « slikke » sont parties intégrantes, les paysages sont variés : des marais desséchés aux terres viticoles, agricole, mais aussi des falaises.
Les communes sont riches en indices archéologiques du Néolithique. Parmi les nombreux exemples cités, tout près de Royan, le camp des ‘‘Rentes’’ a été mis au jour, des outils et pointes de flèches ont été découverts sur la colline de la Garde, « à 800 m à l’est du moulin du Fâ à Barzan ». Au fil des 368 pages, on apprend que 452 entités archéologiques ont été recensés dans l’espace estuarien.
Un territoire aux multiples facettes
L’estuaire, c’est bien évidemment la navigation, avec la réflexion des ingénieurs des Pont et Chaussées de l’époque (1850). Des travaux d’aménagements sont réalisés au XXème siècle pour maintenir le chenal de navigation, et l’adapter à un trafic en évolution. « Le dragage de l’estuaire constitue encore de nos jours un enjeu majeur sur le plan économique, hydraulique et environnemental. »
Cet ouvrage fait la part belle aux architectures religieuses, comme l’église de Ste-Radegonde de Talmont ou celle de St-Fortunat à St-Fort-sur-Gironde. La pierre de taille semble lier les deux bords de l’estuaire. Elle est utilisée pour les « éléments de modénature des façades » et provient de Bourg (33). Seule exception, pour l’escalier du château de Romaneau, à St-Dizant-du-Gua.
Le port, lieu stratégique, avec ses aménagements portuaires, les embarcadères des bateaux à vapeur, est un lieu d’échanges. Son territoire s’en trouve renforcé. On découvre le dessin d’un projet de construction du débarcadère de Port-Maubert, datant de 1859. Parmi les nombreuses informations, on apprend qu’à partir de 1837, les ports de Mortagne et Port-Maubert deviennent des haltes du bateau à vapeur entre Royan et Bordeaux. Le chemin de fer contribue au développement et favorise les échanges. « Il complète le transport fluvial et terrestre. » On se surprend à regarder une photo du tramway arrivant sur le long de la plage de Nauzan, à Royan, en 1930.
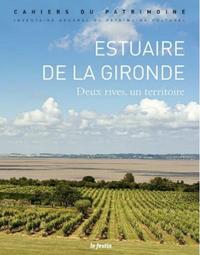
L’estuaire c’est aussi ce territoire d’hommes et de femmes attachés à cette terre. La richesse des eaux permet la saliculture, l’ostréiculture, la pêche. Dans la seconde moitié du XIXème siècle, les moulins à vent et petits moulins à eau installés sur les chenaux ne séduisent plus et laissent place à la viticulture et la polyculture alors en plein essor. Sur les bords de l’estuaire, 127 moulins dont 117 à vent ont été inventoriés.
La lecture de cet ouvrage permet, s’il est besoin de le rappeler, toute l’importance de sauvegarder cette mémoire territoriale, de la valoriser et de la respecter.
Estuaire de la Gironde, deux rives, un territoire - Collection ‘‘Cahiers du patrimoine’’ - Éditions Le Festin - 368 pages - 33 €










